1) La nouvelle Lune
2) Premier croissant et premier quartier
3) Lune gibbeuse et pleine gibbeuse
LES PHENOMENES DES MAREES
1) Le mécanisme
2) Vives-eaux et mortes-eaux
3) Chenaux de marée

|
Sommaire:
1) La nouvelle Lune 2) Premier croissant et premier quartier 3) Lune gibbeuse et pleine gibbeuse LES PHENOMENES DES MAREES 1) Le mécanisme 2) Vives-eaux et mortes-eaux 3) Chenaux de marée |

|
Quand on observe la Lune, on voit que celle-ci, qui tourne autour de la Terre, change de forme et passe successivement par des états appelés phases lunaires. La Lune n'émet pas de lumière ; celle que nous voyons est le reflet de la lumière solaire. Une moitié de la Lune est toujours exposée au Soleil, exactement comme une moitié de la Terre est dans la lumière du jour pendant que l'autre est dans l'obscurité de la nuit. Tandis que la Lune tourne autour de la Terre, nous voyons sous différents angles la partie ensoleillée. Les phases lunaires font référence à l'aspect de la Lune vue depuis notre planète. Nous allons maintenant décrire les phases successives de la Lune. Tentons à présent de déceler le fonctionnement de ces phases. La période entre deux phases identiques, appelée une lunaison, est de 29 jours et l'on a souvent tendance à dire que la lunaison commence avec la nouvelle Lune.
La nouvelle Lune correspond à un alignement, plus ou moins parfait entre la Terre, la Lune et le Soleil. Ceci étant dû au plan de l'écliptique et celui de l'orbite lunaire. Ici la partie visible de la Lune est la partie non éclairée (ne pas confondre avec la face cachée) : on ne peut pas l'apercevoir. De plus, le Soleil étant apparemment très proche de la Lune, lors de cette phase, même si elle laisse apparaître un très léger croissant celui-ci est difficilement observable car noyé dans la lumière solaire. D'autre part, pour l'observation terrestre, la nouvelle Lune se lève lorsque la nuit s'achève, et se couche lorsque celle-ci commence. Invisible pendant la nuit, elle n'est donc pas puissante pour les astronomes : c'est la période idéale pour observer des objets peu lumineux du ciel profond.
Environ trois jours et demi plus tard, on se trouve en présence d'un premier croissant de Lune. Seulement 25% de la face visible de la Lune sont éclairés ; on n'aperçoit ce premier croissant qu'en début de nuit. En effet, du fait de la rotation de la Terre, la Lune va très vite se coucher. D'autre part, lorsque le croissant est suffisamment fin, il est possible de voir de la lumière cendrée. La lumière solaire se réfléchit sur la Terre, et éclaire donc indirectement la Lune. Cet éclairage s'avère très léger et, lorsque la luminosité de la Lune s'accroît, la lumière cendrée se noie totalement.
Encore trois jours et demi, et la Lune entre dans sa phase la plus intéressante pour un observateur muni d'un instrument : le premier quartier. La Terre, la Lune et le Soleil forment un angle de 90 degrés ; 50% de la face visible de la Lune sont donc éclairés. Dans une telle disposition, la lumière rasante, au niveau du terminateur, va faire ressortir tous les cratères qui sont face à la Terre. Le spectacle est simplement superbe, même à travers une simple paire de jumelles. Cette Lune atteint son point le plus haut au début de la nuit, et se couche autour de minuit.
Encore trois jours et demi, et la Lune gibbeuse, éclairée à 75% est présente du début de la nuit, jusqu'à quelques heures avant le lever du Soleil. Il est toujours possible d'admirer les cratères le long du terminateur, mais leur inclinaison diminue leur splendeur.
Nous sommes maintenant à 14 jours de la nouvelle Lune, et entrons dans la phase de pleine Lune. La Lune, la Terre et le Soleil sont alors plus ou moins alignés. La face visible de la Lune est totalement éclairée et, excepté les grandes formation (mers, gros cratères), aucun détail n'est visible à la surface.
En effet, l'absence de lumière rasante, et donc d'ombre, gomme tous ses détails. Durant cette phase, la Lune se lève lorsque le Soleil se couche, et elle se couche lorsque le Soleil se lève. Elle trône donc toute la nuit, et sa grande luminosité empêche l'observation d'objets peu brillants.
Le cycle se produit ensuite avec le dernier quartier, la Lune apparaissant de
nouveau comme 1 demi-cercle, symétrique de celui observé au moment du premier
quartier. Ce cycle s'achève avec la phase de nouvelle Lune, et ainsi de suite à
chaque lunaison. On parle de décroissance pour décrire le passage de la nouvelle
Lune à la pleine Lune, et de déclin dans le sens contraire. Notons qu'au moment de
la pleine lune, la Terre est plus proche du Soleil que la Lune ; à l'inverse, la
Terre est plus éloignée du Soleil que la Lune au moment de la nouvelle Lune.
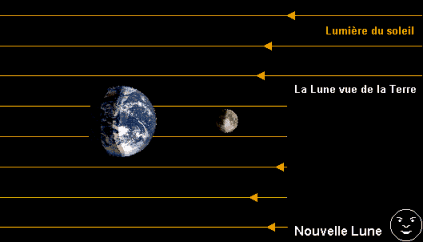


La seule influence qu'exerce réellement la Lune sur la Terre réside en un phénomène qui nous est bien familier : celui des marées. Par nature, les marées sont l'action de la Lune sur la Terre la plus vivement ressentie. La Terre attire la Lune, et celle-ci, soumise aux deux forces opposées de cette attraction et de la force centrifuge, se maintient sur son orbite. Mais inversement, la Lune attire la Terre, cette attraction n'est pas considérable et n'est pas ressentie par nous, mais sur la mer qui a un volume de 1,5.109 km3, l'attraction de la Lune devient assez puissante pour soulever l'océan, former une espèce de bourrelet liquide et donner naissance au phénomène de marée.
Ce phénomène des marées repose sur la loi de gravitation universelle énoncée par Newton en 1682. Ayant eu l'idée de rapprocher la chute libre de la pomme au mouvement de la Lune autour de la Terre, il démontra par le calcul que notre satellite exerce sur la Terre une force d'attraction gravitationnelle, qui se traduit par une protubérance des océans du côté de la Lune et une autre du côté opposé. La protubérance du côté opposé à la Lune dépend du barycentre. Comme expliqué au début du dossier, nous avons vu que la Lune ne tourne pas autour du centre de la Terre. L'une et l'autre tournent autour de leur centre commun, le barycentre, point situé à 4600 km de la Terre sur une ligne reliant leurs deux centres. Comme la Terre oscille autour du barycentre, la force centrifuge est plus forte du côté opposé à la Lune. Ainsi la gravité et la force centrifuge agissent ensemble pour bomber extérieurement la surface de la Terre dans deux directions : vers et à l'opposé de la Lune.
La croûte terrestre subit, elle aussi, l'attraction de la Lune. L'amplitude des déformations ne dépasse cependant pas 30 cm : la rigidité du corps terrestre est estimée être équivalente à celle de l'acier.
Etant donné que la Terre tourne en 24 heures et que la Lune parcourt son orbite
en 27.33 jours, notre satellite passe au méridien donné toutes les 24 heures et
50 minutes. On peut en déduire que l'intervalle entre deux marées est en moyenne
de 12 heures 25 minutes. En un jour, un site côtier connaît donc deux renflements
et deux creux, soit deux marées hautes et deux marées basses. Il est par ailleurs
intéressant de noter que la marée haute ne coïncide pas exactement avec le passage
de la Lune à son point le plus haut dans le ciel. Ce décalage s'explique : la Terre
tournant sur elle-même relativement rapidement, un point donné du globe voit la
Lune changer assez vite de place dans le ciel. Le temps que la masse des océans
réagisse, l'astre lunaire s'est déjà écarté à nos yeux de la position responsable
de la marée. Aussi la marée montante atteindra-t-elle son amplitude maximale alors
que la Lune sera déjà passée à son point le plus haut depuis un moment.
2) Vives-eaux et mortes-eaux
Le soleil exerce aussi son influence sur les masses liquides, mais son action est environ deux fois moindre que celle-ci contribue cependant à expliquer les variations d'amplitude des marées.
Quand le Soleil et la Lune sont alignés avec la Terre (pleine lune et nouvelle lune), leurs actions gravitationnelles s'ajoutent, provoquant de fortes marées (marée de "vive-eau"). Au contraire, lors des premier et dernier quartiers, les influences des deux corps, qui forment un angle droit avec la Terre, se contrarient. Les marées, faibles, sont dites de "morte-eau".
D'autres facteurs entrent en jeu pour déterminer le coefficient des marées, en
particulier la forme et la profondeur du bassin océanique ainsi que la configuration
des côtes. C'est ainsi que les marées peuvent être très peu marquées (comme en
Méditerranée) ou spectaculaires (dans la baie du Mont Saint-Michel). Sur la côte
atlantique, il s'agit de marées semi-diurnes dont la période est de 12h25 minutes
environ. L'amplitude des marées est évaluée par un coefficient de marée compris
entre 30 et 120. Le niveau de l'eau sur les côtes subit des oscillations dont
l'amplitude peut être très importante dans certaines baies, comme celle du Mont
Saint-Michel. Ces baies, avec leurs masses d'eau, constituent des résonateurs.
3) Chenaux de marée
Le flux et le reflux de la mer créent un milieu particulier. Les courants de la
marée redistribuent en permanence une grande quantité de nutriments et
réapprovisionnent les plages. Les organismes marins qui vivent dans ce
milieu doivent être adaptés à la fois aux chocs des vagues et aux passages
fréquents de l'air libre à la submersion complète. Les étoiles de mer utilisent
une ventouse ; les bernacles se fixent en permanence sur les rochers ou les bateaux
et les larves s'ancrent fermement au fond de l'eau. Quand la mer se retire des
poches d'eau demeurent derrière des roches, entre des cordons de sable et des
bassins naturels, il s'agit parfois de simples flaques.